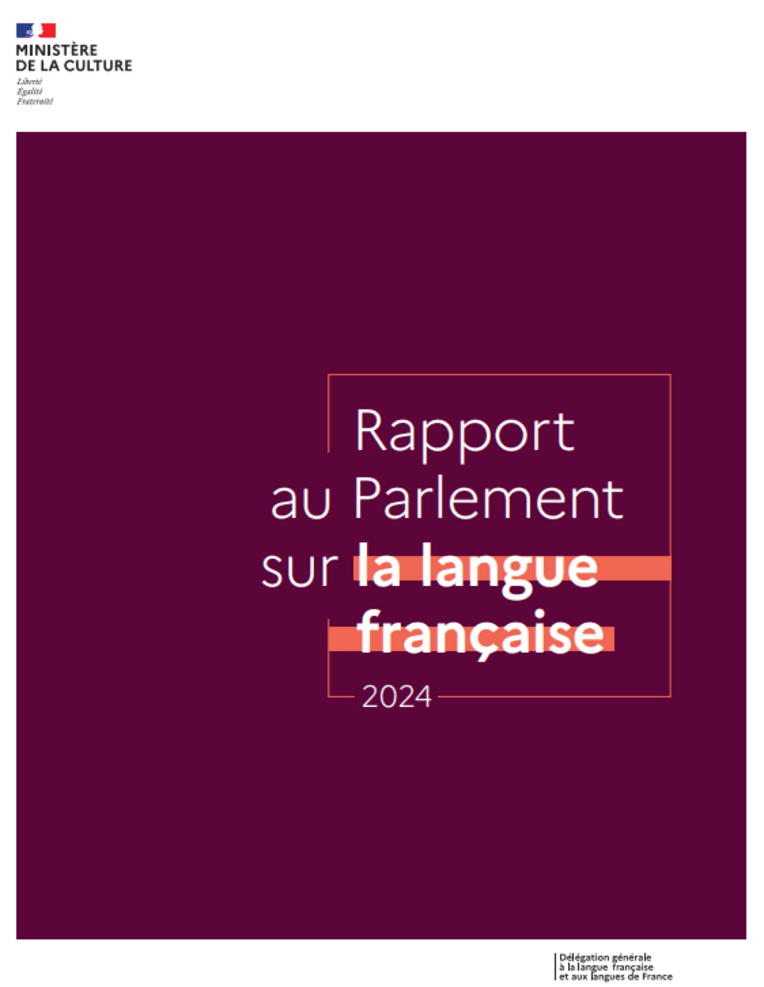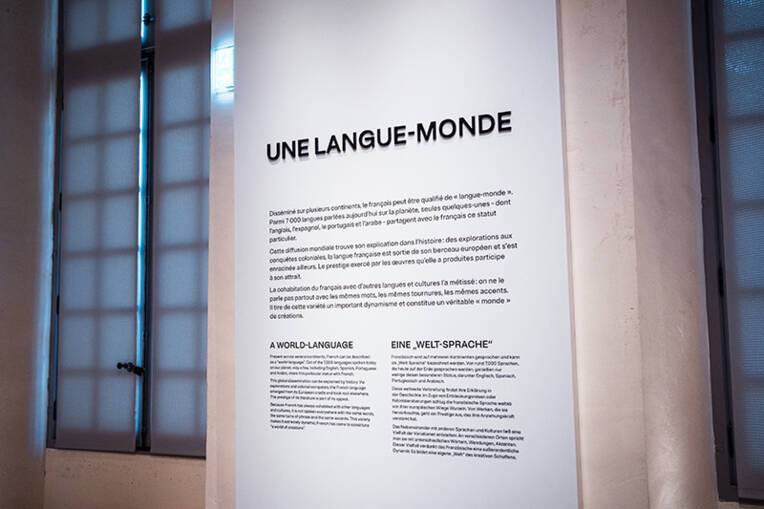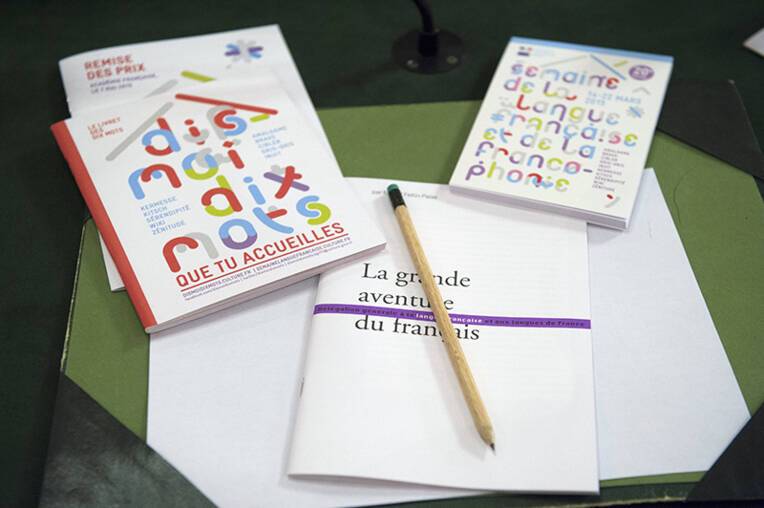La Semaine de la langue française et de la Francophonie est le rendez-vous des amoureux des mots. Chaque année, elle offre au grand public l’occasion de fêter la langue française au travers d’événements organisés en France ainsi que dans les pays francophones.
de la Semaine de la langue française et de la Francophonie
2024
le thème de cette édition 2024
Sur le podium
À quelques semaines des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la « Semaine de la langue française et de la Francophonie » du 16 au 24 mars célèbre le français et le sport. Le thème de cette 29ème édition : « Sur le podium ».
Actualités de l'événement
-
Commentateur sportif : les mots pour faire vivre les émotions du sport
Depuis 2004, Christophe Diremszian est journaliste au service des sports de Radio France internationale (RFI), radio d’actualité diffusée dans le monde entier en français et dans 15 autres langues*. Pour les Jeux de Paris, il est chargé...
Depuis 2004, Christophe Diremszian est journaliste au service des sports de Radio France internationale (RFI), radio d’actualité diffusée dans le monde entier en français et dans 15 autres langues*. Pour les Jeux de Paris, il est chargé...
-
Publication du Rapport au Parlement sur la langue française 2024
Nouveau Rapport au Parlement sur la langue française 2024, portrait des politiques publiques en faveur de la langue française et du plurilinguisme.
Nouveau Rapport au Parlement sur la langue française 2024, portrait des politiques publiques en faveur de la langue française et du plurilinguisme.
-
Le 20 mars, journée internationale de la langue française
Chaque année, le 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans les pays francophones, mais aussi là où la langue française est moins répandue. Plusieurs centaines d'événements sont ainsi organisés pour...
Chaque année, le 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans les pays francophones, mais aussi là où la langue française est moins répandue. Plusieurs centaines d'événements sont ainsi organisés pour...
-
« Dis-moi dix mots sur le podium » : quand la langue française rencontre le sport
Porté par le ministère de la Culture et la Semaine de la Francophonie et de la langue française, l’opération « Dis-moi dix mots sur le podium » suscite, depuis son lancement en septembre 2023, un grand nombre de projets artistiques...
Porté par le ministère de la Culture et la Semaine de la Francophonie et de la langue française, l’opération « Dis-moi dix mots sur le podium » suscite, depuis son lancement en septembre 2023, un grand nombre de projets artistiques...
Espace organisateurs
Vous portez un projet dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie ? Téléchargez ci-dessous le kit de communication de l'événement !
Partenaires
Phenix a créé un nouveau concept de vitrines digitales dans les rues de France dont l’ADN est fondé sur la production et la diffusion de contenus éditoriaux exclusifs et impactants au format stories. Au même titre que Facebook, Instagram et Snapchat, PhenixDigital se positionne comme la première plateforme de vidéos premium diffusées dans la rue, sur un réseau de 1600 écrans digitaux.
Depuis sa création, Phenix s’engage auprès des artistes pour faire vivre l’actualité culturelle dans la rue et révéler les talents de demain.
Écouter et regarder le monde
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français et 16 autres langues) et Monte Carlo Doualiya, la radio en langue arabe. Le groupe émet à l’échelle du monde, en 21 langues. Ses journalistes du groupe et son réseau de correspondants offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une information ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des magazines et des débats. 64 nationalités sont représentées parmi les salariés.
Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent 259,6 millions de contacts (moyenne 2022). Les trois médias du groupe rassemblent plus de 100 millions d’abonnés sur Facebook, X (Twitter), YouTube et Instagram, et ont compté plus de 3,4 milliards de vidéos vues et démarrages audio en 2022. France Médias Monde est la société mère de CFI, l'agence française de coopération médias, et l'un des actionnaires de la chaîne francophone généraliste TV5 Monde.
Présent dans plus de 200 pays et territoires auprès de 432 millions de foyers, TV5MONDE est l’un des plus grands réseaux mondiaux de télévision avec 8 chaînes généralistes régionalisées, 2 chaînes thématiques (TiVi5MONDE la chaîne jeunesse et TV5MONDE Style, la chaîne Art de Vivre) et une plateforme francophone mondiale et gratuite TV5MONDEplus.
TV5MONDE diffuse le meilleur des programmes de l’audiovisuel francophone sous-titrés en 11 langues. Financée par la France, la Suisse, le Canada, le Québec, la Fédération Wallonie-Bruxelles et Monaco, TV5MONDE est par nature en synergie avec ses télévisions partenaires, dont elle fait rayonner les programmes partout dans le monde, mais diffuse aussi des productions propres et des programmes acquis dans le paysage audiovisuel francophone.
Du 16 au 24 mars 2024, TV5MONDE célèbre, sur toutes ses chaînes, son site et ses réseaux sociaux, la 29e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie avec des rendez-vous d’information, des magazines et des documentaires consacrés à la thématique, parmi lesquels la websérie Motamoteurs! dédiée au décryptage des expressions francophones africaines et la deuxième saison "D'une langue à l'autre" ainsi que la promotion de l'opération "Dis-moi dix mots" via le dispositif d'apprentissage et d'enseignement du français.